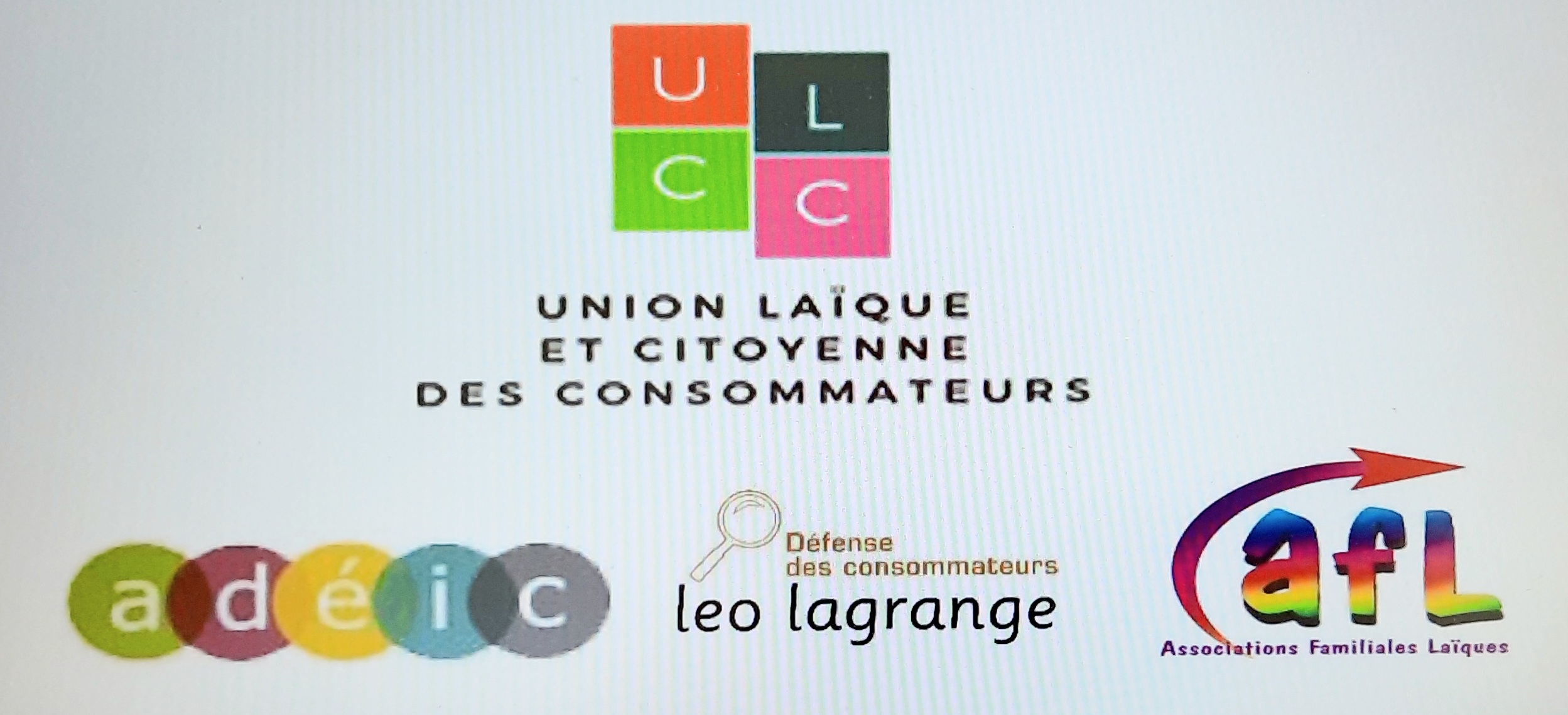Ouverture du discount Atacadao en France : une « arme anti-inflation » ou « pro-bénéfices » ?
La marque Carrefour lance un nouveau type de discount sur le territoire français, avec un choix réduit et des prix cassés : mais les promesses de cette multinationale de la grande distribution seront-elles à la hauteur des attentes et des besoins des consommateurs ?
Annoncé dès octobre 2022 par le PDG de Carrefour, le premier magasin ATACADAO en France a ouvert ses portes le 20 juin dernier à Aulnay-Sous-Bois, en Seine-Sain-Denis (93).
ATACADAO, ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais vous serez certainement amené à l’entendre de plus en plus. Rachetée en 2007 par le groupe Carrefour, cette entreprise brésilienne, qui dispose de 300 magasins au Brésil, vend des produits de consommation courante à des prix cassés, grâce à un concept de « magasin-entrepôt » où les produits sont directement stockés dans les rayons et où le client se sert dans les cartons. Ces magasins incitent les consommateurs à acheter en gros, car le prix est dégressif en fonction de la quantité achetée : des produits comme le sucre, la farine, le riz, peuvent ainsi s’acheter par paquets de 10 ou 20 kg, à des prix défiant – en théorie – toute concurrence.
En France, le concept a pris du temps à se concrétiser : d’abord prévu à Sevran, qui a refusé l’implantation du magasin sur son territoire, le magasin a finalement été accueilli par la ville d’Aulnay-Sous-Bois, en lieu et place d’un ancien hypermarché Carrefour. Le jour de l’ouverture, des clients ont fait le déplacement des communes de Seine-Saint-Denis avoisinantes, et même du Val-d’Oise pour tester le concept et profiter de promotions. Cependant, les avis sont mitigés. Si des clients se réjouissent de profiter des prix dégressifs en quantité, notamment pour subvenir aux besoins de familles nombreuses, d’autres pointent du doigt une différence de prix parfois minime avec d’autres enseignes, surtout si ces produits sont achetés en faible quantité. L’aspect « entrepôt » et les larges allées sans signalétique peuvent aussi confondre certains visiteurs. Enfin, l’un des clients interrogés par Le Parisien souligne que tout est fait pour pousser à la surconsommation, en particulier de produits sucrés et caloriques.
Un discount très lucratif
En effet, on peut s’interroger sur l’intention de ce genre de magasins. Derrière la façade d’un discount « anti-crise » qui profiterait aux populations les plus précaires, se profile une stratégie très rentable pour Carrefour, visant à accroître encore davantage son chiffre d’affaires. Au Brésil, l’enseigne représente les deux tiers du chiffre d’affaires de Carrefour et 80% de sa rentabilité. En France, le magasin s’adresse à la fois aux professionnels, en ouvrant dès 7 heures, mais également aux particuliers, que l’enseigne compte attirer pour en faire 70% de son chiffre d’affaires. Cette double casquette lucrative ne profite cependant pas aux salariés de l’entreprise. Pour faire fonctionner le magasin d’Aulnay-Sous-Bois, ils sont 220, un tiers de moins qu’à l’époque de l’hypermarché Carrefour. Un plan de départ volontaire a écrémé l’équipe de 96 salariés. On peut donc supposer, pour les salariés restants, un travail plus pénible et plus précaire, sur une surface immense de 10 000 m². Cela fait écho aux conditions de travail dégradées dans d’autres discounts, comme la franchise Action, qui avait déjà fait l’objet d’une enquête en 2024.
Qui plus est, la promotion des lots de 10 ou 20 produits similaires incite surtout les clients à consommer plus que ce dont ils ont besoin, et la différence de prix passe au second plan. Certains produits, comme l’eau gazeuse de marque par exemple, sont même vendus plus chers que dans des enseignes voisines, comme Auchan ou Leclerc. Plus qu’un « coup de pouce » financier, il s’agit bien de faire acheter beaucoup, et pas toujours de la meilleure qualité, à des populations précaires qui espèrent trouver une marge de dizaines de centimes sur leurs achats. Nous sommes loin d’un projet philanthrope, et plus près d’une manne financière qui repose sur des consommateurs plus vulnérables. Ça n’est d’ailleurs pas un hasard si le magasin ouvre à Aulnay-Sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, et non dans les banlieues plus aisées d’Île-de-France.
La direction de Carrefour a annoncé tester dans un premier temps le concept avant d’envisager, en cas de succès, l’ouverture de nouveaux points de vente à travers la France. Nous espérons néanmoins que cette expansion ne se fera pas aux dépens d’un salariat plus précarisé et de consommateurs moins bien informés sur ce qu’ils achètent.
Ndlr : Le titre reprend les propos du PDG de Carrrefour Alexandre Bompard, qui a parlé d'Atacadao comme d'"arme anti-inflation" lors de l’inauguration du projet en 2022. Source : lsa-conso.fr