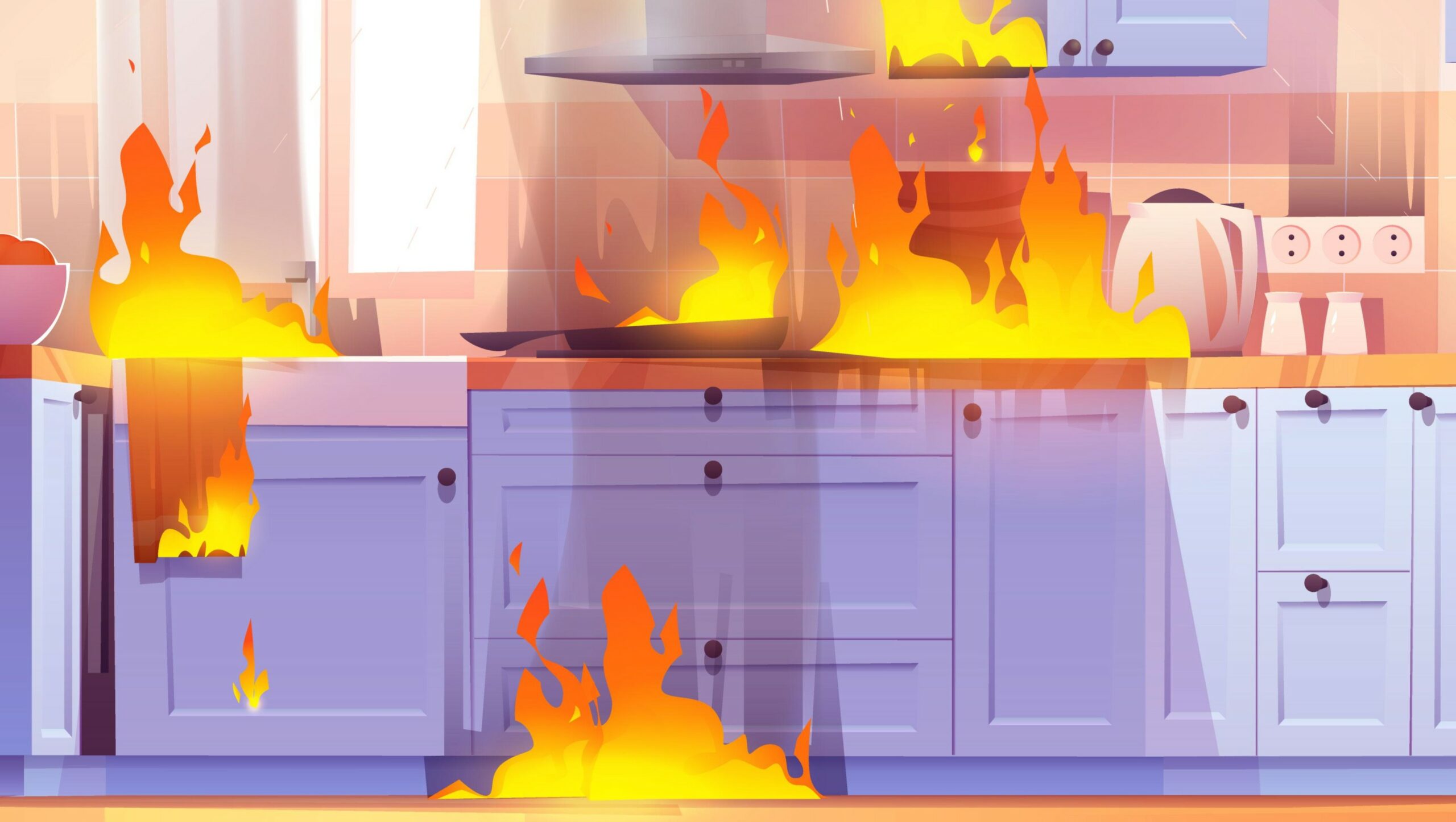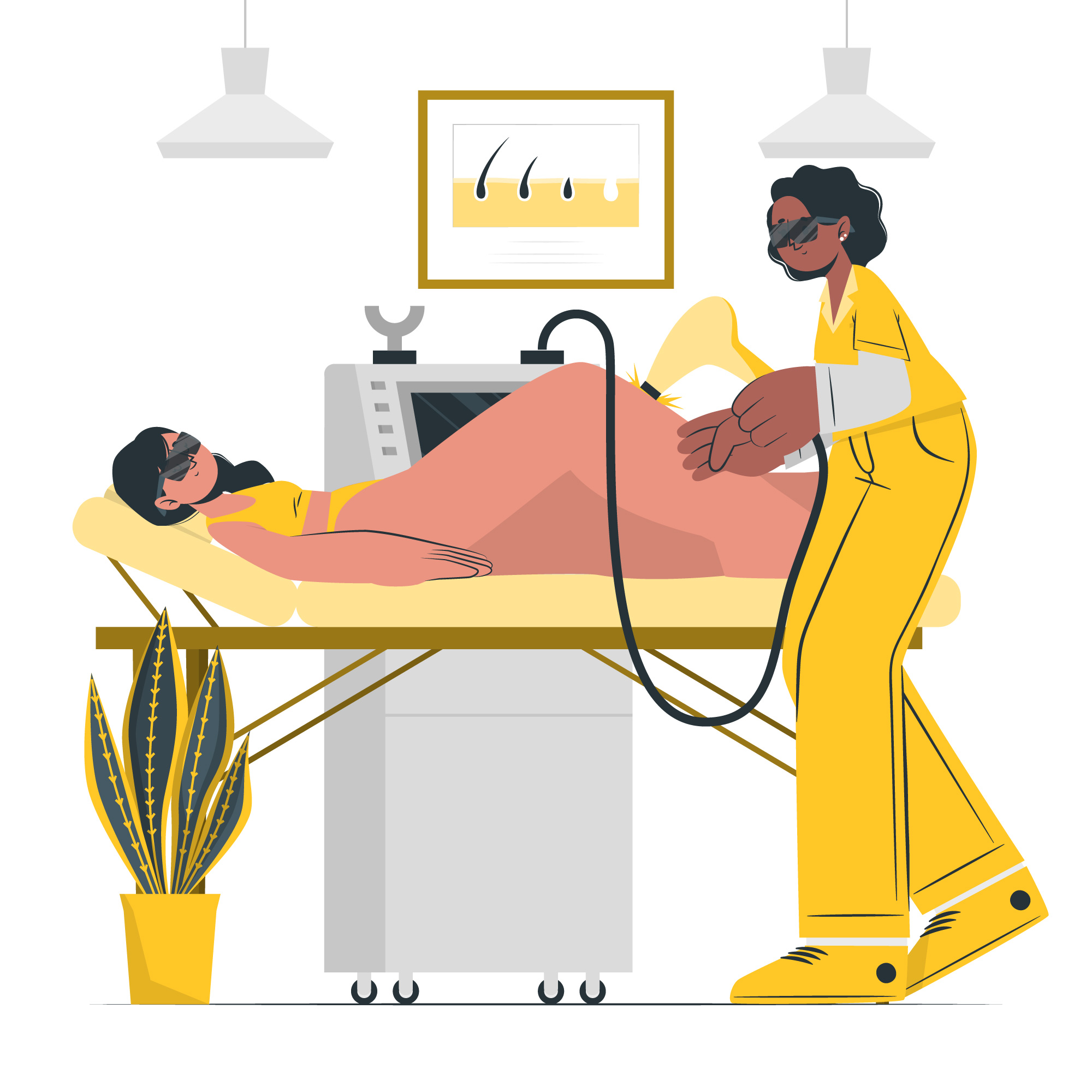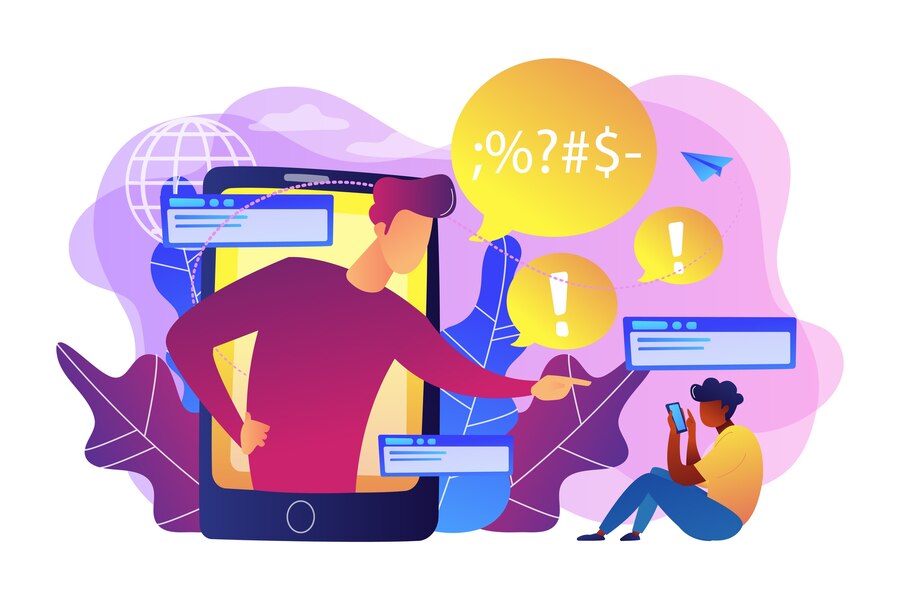SITUATION
Déménageant dans un nouvel appartement, Madame Z souhaite acquérir une literie flambant neuve. Elle se tourne donc vers internet et commande en ligne un lit et un matelas sur mesure pour le montant de 1 399 euros, en provenance de la Turquie.
Un délai de livraison en 8 à 10 semaines lui est donné, entre fin octobre et fin novembre. Parfait pour Madame Z qui déménage dans cet intervalle. Fin octobre 2022, le vendeur indique à Madame Z que sa commande a quitté la Turquie.
Fin novembre, s’inquiétant de ne pas avoir reçu plus d’informations sur la date d’arrivée de sa commande depuis plus d’un mois, Madame Z relance le vendeur qui finit par lui dire qu’il l’informera sur une nouvelle date de livraison « en temps voulu ».
Madame Z continue à attendre et attendre, mais en décembre 2022, aucune trace de sa commande.
Le délai de livraison dépassé, et fatiguée d’attendre, Madame Z adresse au vendeur de literie une lettre recommandée avec accusé de réception, le mettant en demeure de procéder à la livraison de sa commande sous 14 jours à compter de la réception du courrier. Elle n’obtient pas de réponses.
En conséquence, en janvier, Madame Z envoie une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, où elle le notifie de sa volonté de résilier le contrat et le met en demeure de procéder au remboursement des sommes versées pour l’achat du lit et du matelas, cela sous 14 jours. Elle n’obtient, encore une fois, pas de réponses de la part du vendeur.
En février 2023, le colis de Madame Z finit par arriver mais celle-ci n’en veut plus. Entre temps, elle a fait appel à un autre fournisseur de literie. Elle rappelle donc au vendeur, par message, que le contrat a été résolu et qu’il est donc tenu de la rembourser.
De plus, le remboursement devant avoir lieu à la réception de la lettre envoyée début janvier selon la lettre envoyée, le vendeur est désormais redevable du prix d’achat total de la commande, mais aussi d’une majoration prévue par le Code de la consommation, ici 20%, soit 1678,80 euros, plus d’un mois s’étant écoulé depuis la réception du courrier.
Face à un nouveau refus du vendeur, Madame Z a alors fait appel à l’ADEIC qui a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur le mettant en demeure de respecter son obligation de remboursement. L’ADEIC l’a également informé que s’il repoussait à nouveau ce remboursement, il s’exposerait à la majoration de 50% prévue par le Code de la consommation lorsque le remboursement a lieu deux mois après la mise en demeure de remboursement.
Madame Z a parfaitement effectué toutes les démarches prévues par la Loi, appelant le vendeur à s’acquitter de son obligation. Les délais de livraison dépassés, elle a pu demander le remboursement des sommes versées pour l’achat de la literie.
Malgré le courrier rédigé par l’ADEIC, le vendeur a continué de refuser de la rembourser, arguant que le colis avait fini par arriver, bien que Madame Z n’ait pas accepté cette livraison. Elle a donc dû faire appel à un conciliateur de justice.
QUALIFICATION JURIDIQUE (Code de la Consommation):
- Article L216-1 à obligation de délivrance du bien dans le délai indiqué au consommateur ou le cas échéant, sous 30 jours après la conclusion du contrat
Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L. 224-25-4.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Le présent chapitre s’applique également à la fourniture d’un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport.
L’indication d’une livraison « en temps voulu » fournie par le vendeur est donc contraire aux dispositions du Code de la consommation qui exige davantage la précision d’un délai par le professionnel. En l’absence de celle-ci, le délai est fixé à 30 jours après la conclusion du contrat.
- Article L216-6 à Suspension du paiement jusqu’à exécution du contrat
Résolution du contrat après mise en demeure d’exécuter son obligation avec délai supplémentaire de livraison
Résolution immédiate du contrat possible sans devoir adresser une lettre recommandée avec accusé de réception s’il y a un refus de délivrance, si le vendeur ne livrait manifestement pas le bien ou le service, ou si le délai de livraison constituait une condition essentielle pour le consommateur
Seule la force majeure peut exonérer le vendeur de l’exécution de son obligation de délivrance du bien.
I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
- Article L216-7 à Obligation de remboursement dans les 14 jours après la résolution du contrat
Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
- Article L241-4 à Majorations automatiques en cas de retard de remboursement
Lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement.