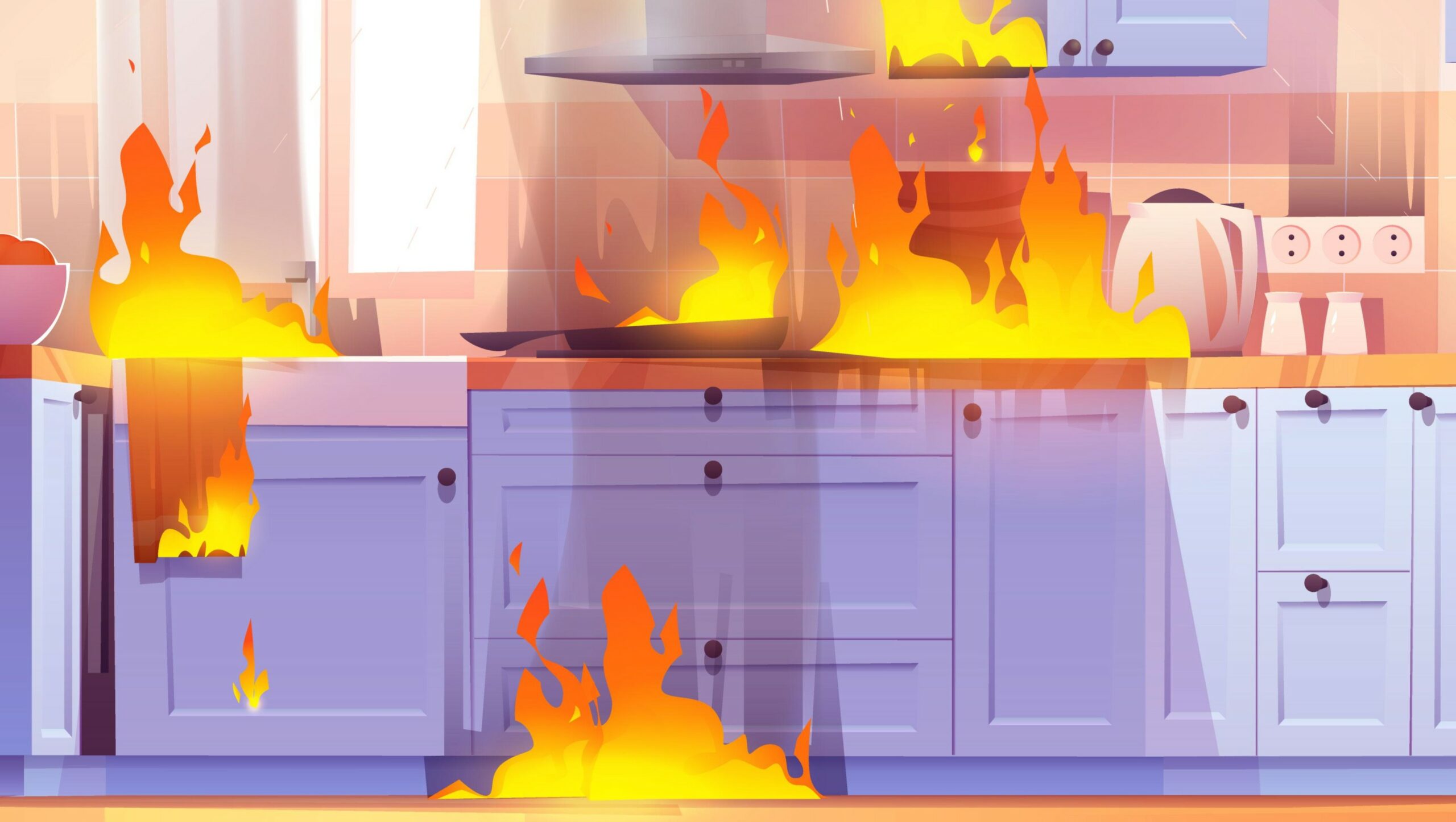En France, 800 000 personnes de plus de 75 ans sont victimes chaque année d’abus de faiblesse, et 85 % des seniors déclarent avoir subi au moins une tentative d’escroquerie dans l’année. Les seniors, en tant que public « fragile », sont ainsi devenus le public le plus visé par les arnaques numériques.
A l’Adéic, nous disposons sur notre site Internet de contenus utiles pour informer et alerter tous les consommateurs sur les arnaques, notamment :
- Une rubrique d’arnaques répertoriant des cas et permettant aux lecteurs de repérer les tactiques frauduleuses.
- Des supports pédagogiques (ConsoMag et vidéos) traitant de conseils concrets liés à la fraude numérique ou aux mauvais usages.
- Un communiqué de sensibilisation plus large sur la protection contre les fraudes.
N’hésitez pas à les consulter.
Les 3 grandes familles d’arnaques en ligne qui reviennent le plus
Le phishing (hameçonnage)
Un message imite une banque, un livreur, un service de l’état. L’objectif de l’arnaqueur est de récolter vos données personnelles ou vos informations bancaires. Savoir reconnaître un message de phishing permet d’éviter de tomber dans le piège. Méfiez-vous notamment des adresses d’expéditeur ou de site inhabituelles. Rendez-vous sur le site officiel en question pour ne pas être dirigé vers un faux site se faisant passer pour un organisme.
L’abus commercial déguisé
Il s’agit d’une offre trop belle pour être vraie qui promet une aide ou un équipement presque gratuit. L’objectif est de faire signer un contrat inutile, trop onéreux ou même difficile à résilier. Les exemples connus de cet abus commercial sont par exemple les offres de panneaux solaires ou pompes à chaleur subventionnés, qui conduisent par la suite les personnes à s’endetter à des taux d’intérêts abusifs sur de longues périodes pour des installations énergétiques.
L’arnaque financière
Elle vise directement le compte bancaire. Les arnaqueurs tentent d’obtenir par la manipulation vos codes bancaires confidentiels. Les méthodes évoluent mais les mécanismes restent les mêmes :
- se faire passer pour des conseillers bancaires ayant besoin de votre aide et de vos codes pour faire opposition à des supposés virements frauduleux
- cloner la voix de vos proches en utilisant l’Intelligence Artificielle.
- entrer avec le sénior, via Internet, dans une relation sentimentale fictive puis tenter ensuite, par différents moyens, de lui soustraire des sommes d’argent plus ou moins conséquentes.
Les escrocs misent sur certaines fragilités des séniors :
L’isolement social: il conduit les seniors à accorder facilement leur confiance à des figures d’autorité (conseillers bancaires, service des impôts…) pour lesquelles se font passer les escrocs. Ceux-ci savent bien que leurs victimes n’ont personne vers qui se tourner pour obtenir de l’aide, des conseils ou une simple vérification.
Le manque d’habilités numériques: cela rend complexe, pour les seniors, le fait de se repérer dans les mails, les sites etc. L’escroc peut profiter du manque de repères de sa victime pour immiscer des sentiments d’urgence et de peur chez elle et accroitre la confusion dans laquelle elle est déjà. Ainsi, il est essentiel que les proches des séniors se montrent vigilants, les accompagnent dans leurs démarches en ligne et créent autour d’eux un filet de sécurité.
10 conseils clés pour éviter les arnaques en ligne
- Ne communiquez jamais vos codes bancaires par message ou appel
- Méfiez-vous des situations présentées comme urgentes, qui cachent souvent un stratagème de tromperie de la part de votre interlocuteur
- Ne cliquez sur aucun lien reçu, ouvrez plutôt le site ou l’application vous-même
- Vérifiez l’expéditeur : fautes, chiffres dans le nom, adresse bizarre… sont des signes qui doivent vous mettre la puce à l’oreille
- Refusez tout logiciel inconnu et tout accès à distance
- Définissez un mot de passe différent pour chaque site, même s’il reste facile à retenir, mais fiable.
- Activez la double vérification par SMS quand elle est proposée
- Demandez à un proche de valider vos démarches avant toute action sensible
- Ignorez les gains et jeux concours non sollicités
- Évitez de répondre aux inconnus : les escrocs repèrent ceux qui interagissent
Pour conclure, soyez vigilant. Rester attentif aux signes trahissant une arnaque reste le moyen le plus sûr pour ne pas en être la victime. Si toutefois vous êtes victime, ne restez pas sans rien faire. Les bons réflexes peuvent encore limiter les dégâts : appelez immédiatement la banque pour bloquer ou annuler une opération, faites-vous conseiller par des personnes de confiance, conservez des preuves. Déposez plainte si nécessaire. A l’Adéic, nous sommes là pour vous aider. N’hésitez pas à signaler l’arnaque dont vous avez été victime à l’adresse suivante https://www.adeic.fr/arnaques/ et à nous contacter par mail contact@adeic.fr ou par téléphone 01 44 53 73 93.
Photo libre de droit-Pixabay