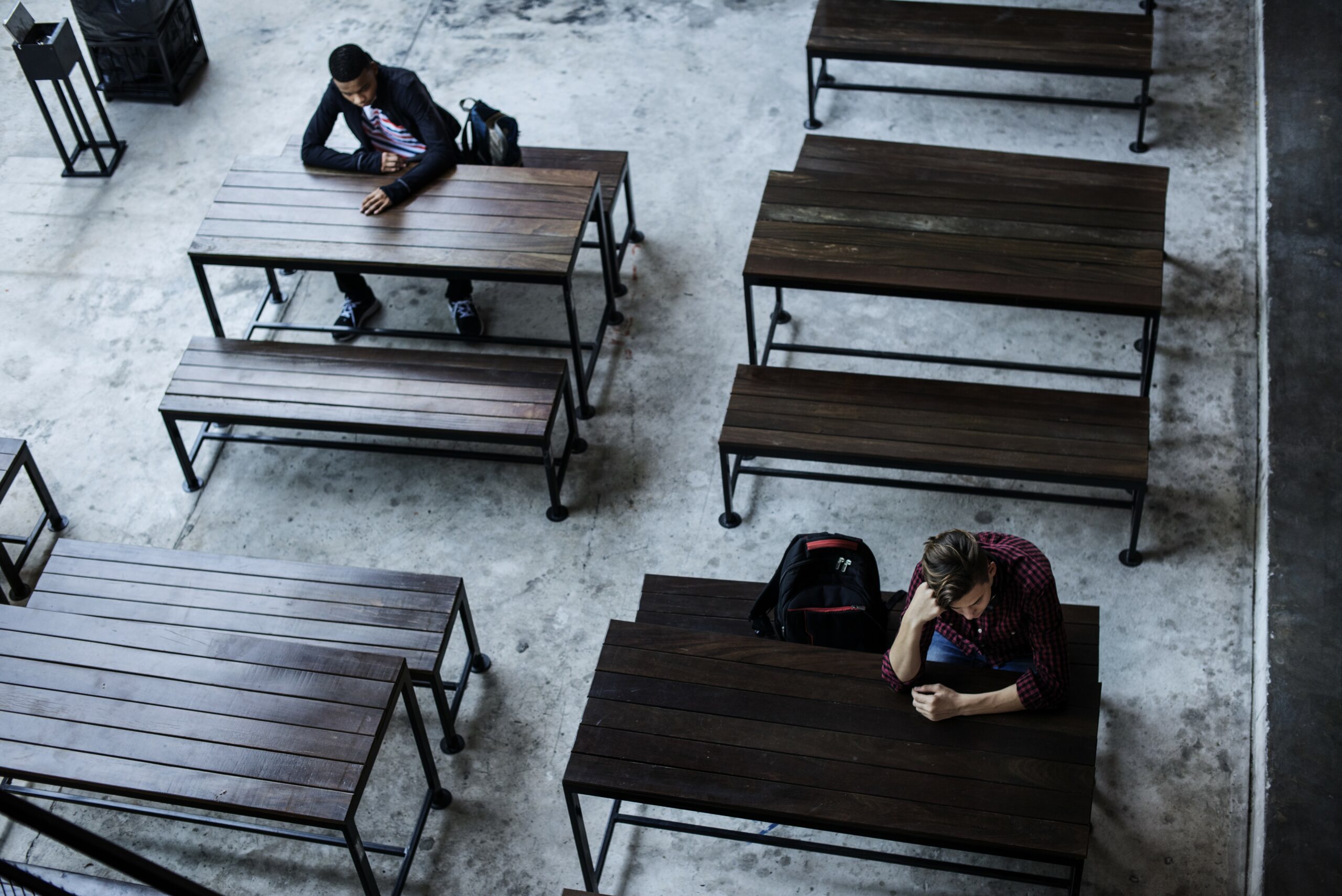Dix ans après la création du Nutri-score, et juste après l’amélioration de son algorithme, de nouveaux outils d’évaluation et de traçabilité des aliments voient le jour en France, à des stades plus ou moins avancés. Si les consommateurs plébiscitent ce genre d’affichages, les industriels y sont rarement contraints.
Selon une étude de 2023, citée par le ministère de l’Economie, plus de 8 français·e·s sur 10 trouvent important de connaître l’origine des produits qu’ils achètent. Si l’origine géographique des produits bruts comme les fruits et légumes est obligatoire en rayons, celle des produits transformés n’a jamais fait, jusqu’à présent, l’objet d’une loi contraignante.
C’est pourquoi Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Entreprises, du Tourisme et de la Consommation, a lancé en mars dernier la démarche « Origine-Info », ayant pour but d’indiquer sur les emballages des produits alimentaires, même transformés, l’origine de leurs principaux ingrédients. Cette démarche, dont le cahier des charges et le logo devraient être dévoilés au cours du mois de mai, s’avère cependant non exhaustive : il s’agira de préciser la provenance des deux ou trois ingrédients principaux du produit, sans code couleur particulier. Un QR code pourrait venir compléter ces informations.
Qui plus est, si de premières expérimentations sont prévues dans nos magasins pour cet été, cette démarche reste sur la base du volontariat. Seules les enseignes de « bonne volonté » proposeront donc des produits étiquetés « Origine-Info ». Pour la ministre, « une quarantaine de marques industrielles » serait volontaire pour tester le dispositif, parmi lesquelles Fleury Michon, Bonduelle, D’Aucy, Yoplait, et les marques de distributeurs (MDD). Mais si ces affichages restent à la bonne volonté des marques, celles-ci risquent d’apposer l’origine des aliments seulement si cela redore leur image, et de laisser toute une partie des ingrédients dans un flou géographique. Des négociations à venir, en 2025 à Bruxelles, permettront peut-être d’engager une démarche plus contraignante à l’échelle européenne.
L’origine des viandes s’étend aux produits transformés
Autre progrès – apparent – dans la transparence de l’information : depuis un décret du 4 mars dernier, l’origine des viandes doit apparaître dans les compositions des produits transformés. Cette décision concerne les restaurants, cantines et établissements, proposant des repas à emporter ou à livrer. Si la viande « brute » et le poisson étaient déjà soumis à une traçabilité stricte, il n’en était rien, jusqu’alors, pour des produits transformés comme les nuggets ou le cordon bleu. Le décret vise aussi à préciser si l’animal a été élevé et abattu au même endroit, ou s’il s’agit de deux pays différents.
Néanmoins, ce décret, adopté essentiellement pour répondre aux revendications des agriculteurs (qui exigeaient l’indication systématique de l’origine des produits), s’avère limité et peu contraignant : ces obligations ne s’appliquent que si le restaurateur « a connaissance » de l’origine de ses produits. Or, rien ne l’oblige pour l’instant à vérifier ces informations de son fournisseur. De plus, dans certaines conditions, la mention du pays peut être remplacée par la mention « UE » ou « non UE », des indications vagues et peu marquantes pour les consommateurs. Il s’agit là encore d’une décision prise rapidement, face à l’urgence d’une crise, mais qui ne se donne pas les moyens d’être appliquée systématiquement.
Un projet d’étiquette pour évaluer le bien-être animal ?
En plus de l’origine, d’autres critères font l’objet d’une attention croissante de la part des consommateurs. C’est le cas du bien-être animal, défendu par de nombreux labels, mais qui n’a bénéficié d’aucune évaluation homogène jusqu’alors. C’est pourquoi l’ANSES a publié le 2 mai dernier un rapport en faveur d’un étiquetage commun à toutes les bêtes, sur tout le territoire. Pour l’Agence nationale de santé, il importe de fonder l’évaluation du bien-être animal sur des indicateurs scientifiques du bien-être, mesurés directement sur les animaux, et pas uniquement sur leurs conditions d’élevages. Le rapport propose une classification harmonisée à 5 niveaux, sur le modèle du nutri-score. Si le niveau E correspond au respect minimum des exigences européennes, les niveaux supérieurs prennent davantage en compte les conditions de vie, ainsi qu’un « état mental et physique positif » de l’animal, que ce soit au cours de l’élevage, du transport et de l’abattage.
Ainsi, l’ANSES identifie six domaines présentant des facteurs de risque : la génétique, l’alimentation, l’environnement, la santé, les interactions comportementales et l’état mental. L’évaluation porterait sur l’animal en priorité (sa production, sa motivation, son sommeil, ses blessures…) et sur son environnement (hébergement, place de couchages, nature du sol…). L’agence prend également en compte les conditions de vie des ascendants des animaux, qui doivent être renseignées, faut de quoi la note ne dépasserait pas le niveau C.
Le travail de l’ANSES paraît cohérent, précis et applicable, et coïncide avec une réelle préoccupation européenne. Il correspond aussi au souci croissant des consommateurs de savoir où, comment et avec quelles précautions ont été produits les aliments qu’ils achètent. Il reste à espérer, et à lutter pour qu’une volonté politique fasse suite à ces appels, et fasse prévaloir l’information du consommateur sur des intérêts purement financiers.
MAJ : Depuis l’été 2024, le label Origin’Info est en cours d’expérimentation avec un logo unique sur plus d’une centaine de marques en magasin. Plus d’infos sur economie.gouv